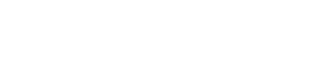-
Patients / public
-
- Nos services
- Nos médecins
- Prendre / Annuler un rendez-vous
- Venir à l'hôpital
- Vaccination
-
Vous allez être hospitalisé(e)
- Modalités de paiement, tarifs
- Payer ma facture en ligne
- Soutenez les Hôpitaux de Chartres
- Actualités
- Livret d'accueil patients
- Partenaires
-
Institutionnel
-
- Professionnels / étudiants
Recherche
Antibiothérapie
Antibiothérapie
Source : site de l’Assurance Maladie (AMELI.fr)
Définition et bon usage des antibiotiques :
Les antibiotiques sont efficaces uniquement contre les bactéries. Depuis leur première utilisation au milieu du 20ème siècle, ils ont permis de progresser dans le traitement des maladies infectieuses bactériennes. Mais leur usage massif et souvent inapproprié fait apparaître des résistances.
Qu'est-ce qu'un antibiotique ?
Les antibiotiques sont des médicaments composés de molécules empêchant le développement des bactéries. Il existe plusieurs familles d'antibiotiques.
Chaque antibiotique s'attaque spécifiquement à une bactérie ou à un groupe restreint de bactéries.
Les antibiotiques n'ont aucune efficacité sur les virus ou sur les champignons.
Pour comprendre la différence entre antibiotiques et antiviraux
À quoi servent les antibiotiques ?
Victimes de leur succès, les antibiotiques sont trop souvent considérés comme un remède qui soigne tout, tout de suite... mais ce n'est pas vrai.
- Les antibiotiques sont efficaces uniquement contre les maladies d’origine bactérienne :
- cystite
- pneumonie
- angine bactérienne avec Test de Diagnostic Rapide positif en faveur d'une origine bactérienne de l'angine,
- méningite bactérienne...
- Les antibiotiques ne peuvent rien contre les maladies d’origine virale telles que la rhinopharyngite, la grippe, la bronchite aigüe, ou la plupart des angines.
- Les antibiotiques ne soulagent pas directement les symptômes. Fièvre, toux, maux de tête, troubles digestifs, courbatures... Les antibiotiques ne peuvent rien contre ces symptômes... lorsque l’infection est virale. Des médicaments existent pour les soulager, notamment le paracétamol pour la fièvre et les courbatures.
- Les antibiotiques ne permettent pas de guérir plus vite d'une infection virale. En cas de maladies virales courantes, la personne guérit naturellement en 1 à 2 semaines, sans antibiotique... Le corps peut se défendre seul contre ces virus fréquents l’hiver, il lui faut juste un peu de temps.
Comment préserver l'efficacité des antibiotiques ?
L’usage inapproprié et trop souvent incorrect des antibiotiques a contribué au développement et à la dissémination de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Cette résistance se développe lorsqu’une bactérie se transforme et développe des mécanismes de défense, diminuant ou annulant l’action des antibiotiques qui la combattent.
Cette résistance des bactéries aux antibiotiques, appelée antibiorésistance, s'est développée progressivement et pourrait devenir l’une des principales causes de mortalité dans le monde : elle provoquerait chaque année en France près de 12 500 décès. Cette résistance remet en question la capacité à soigner les infections, même les plus courantes.
Pour lutter contre le développement des résistances bactériennes et préserver l’efficacité des antibiotiques, deux mesures sont essentielles :
1. Prévenir les infections : c'est la première étape de la lutte contre l'antibiorésistance. Une infection évitée : c'est un antibiotique préservé !
Pour prévenir les infections :
- lavez-vous fréquemment les mains, surtout après un passage aux toilettes, au retour du travail à votre domicile, avant de préparer un repas, après avoir éternué et vous être mouché, avant et après avoir pris soin d'une personne, avant et après avoir pris soin de votre animal ;
- conservez les aliments et préparez les repas dans les conditions adaptées pour chaque aliment ;
- respectez les vaccinations obligatoires et conseillées : elles vous protègent, vous et votre entourage. Certaines maladies bactériennes sont prévenues grâce à la vaccination (par exemple, contre la coqueluche, contre certains germes responsables de pneumonies ou méningites : le pneumocoque, le méningocoque, l'haemophilus influenzae...)
Moins d'infections = moins d'antibiotiques prescrits = moins de résistance des bactéries aux antibiotiques
2. Mieux utiliser les antibiotiques
Faites confiance à votre médecin car il sait quand les antibiotiques sont nécessaires et quand ils ne le sont pas. Ne prenez pas d'antibiotiques sans prescription et sans avis médical.
Votre médecin vous prescrit des antibiotiques uniquement pour traiter des infections bactériennes. Il choisit l'antibiotique le plus efficace contre la bactérie en cause. Dans certains cas, une analyse bactériologique avec un est nécessaire.
Lorsque votre médecin vous prescrit un traitement par antibiotiques, veillez à :
- bien respecter la dose, la fréquence des prises et la durée de votre traitement antibiotique prescrit par un médecin ;
- ne pas utiliser votre traitement pour quelqu'un d'autre. Un traitement est spécifiquement prescrit pour tel type d'infection et adapté à chaque personne ;
- demander conseil à votre médecin traitant si vous pensez présenter un effet indésirable à votre traitement (éruption, nausées...) ;
- ne pas arrêter votre traitement prématurément, même si votre état s'améliore. Vous devez prendre l’antibiotique pendant la durée prescrite ;
- une fois le traitement terminé, ne pas réutiliser un antibiotique, même si vous avez des symptômes qui ressemblent à ceux que vous avez eu antérieurement ;
- à la fin du traitement, rapporter à votre pharmacien toutes les boîtes entamées ou non utilisées.
Ensemble, préservons les antibiotiques. En les préservant aujourd’hui, nous pourrons bénéficier de leur efficacité le jour où nous en aurons vraiment besoin. Les antibiotiques : utilisés à tort, ils deviendront moins forts.
Les maladies qui guérissent sans antibiotiques :
Grippe, angine, bronchite… certaines maladies courantes font souvent l’objet de consommation d’antibiotiques, alors qu’elles sont d’origine virale dans la majorité des cas. Faites le point sur les maladies qui guérissent naturellement en quelques jours.
D’origine virale, la grippe saisonnière est une infection respiratoire aiguë très contagieuse. L’épidémie revient chaque automne et dure jusqu’au printemps. La vaccination permet de la prévenir.
La rhinopharyngite débute par une fièvre (souvent inférieure à 39 °C) et un mal de gorge. Ce dernier persiste souvent de 1 à 3 jours. Le nez se bouche puis coule pendant deux à dix jours. Les sécrétions sont d'abord claires puis deviennent épaisses, jaunes ou verdâtres. Une toux peut également apparaître et durer quelques jours.
L'angine est le plus souvent une maladie sans gravité. L’angine est une inflammation des amygdales situées au fond de la gorge. Chaque année en France, environ 9 millions d’angines sont diagnostiquées.
Il existe 2 types d’angine : l’angine virale, la plus courante, due à un virus et l’angine bactérienne due à une bactérie le plus souvent un « streptocoque ». Elles nécessitent des traitements différents. Seule l'angine bactérienne, confirmée par le TDR ou test de diagnostic rapide nécessite un traitement antibiotique.
La bronchite aigüe est une inflammation des bronches causée, le plus souvent, par un virus. Elle se manifeste par une toux sèche puis grasse, de la fièvre et parfois une gêne respiratoire.
Chaque hiver, la bronchiolite sévit auprès des nourrissons et petits enfants. Elle débute généralement par un simple rhume ou par une rhinopharyngite, puis une toux et une gêne respiratoire apparaissent.
Contexte et objectifs de l’antibiothérapie à l’Hôpital:
Depuis que les médicaments anti-infectieux sont utilisés, la résistance des micro-organismes (bactéries, champignons, parasites mais également virus) à ces médicaments n’a cessé d’augmenter. Cette évolution a été particulièrement spectaculaire pour les antibiotiques depuis une vingtaine d’années.
La prévalence de la résistance bactérienne aux antibiotiques est préoccupante dans les établissements de soins en France. Le choix d’antibiotiques efficaces y est rendu difficile, voire impossible dans certaines infections à bactéries totalement résistantes aux antibiotiques. Dans le même temps, le nombre des antibiotiques mis à disposition est de plus en plus limité ces dernières années (peu de nouvelles molécules, difficultés d'approvisionnement pour des anciennes molécules). Par ailleurs, cette prévalence d’eubactéries multi résistantes, et la gravité des infections qu’elles induisent, amènent à prescrire largement les quelques molécules encore actives, souvent les plus récentes et/ou de spectre étendu. La France est d’ailleurs un des plus gros consommateurs d’antibiotiques en Europe.
Ces pratiques favorisent l’émergence de nouvelles résistances et de plus, induisent des surcoûts.
La prescription des antibiotiques doit prendre en compte non seulement l’effet recherché sur l’infection des malades traités, mais aussi leurs effets sur l’écologie bactérienne et donc sur la collectivité. Il est ainsi essentiel de retarder l’apparition et/ou l’extension des résistances bactériennes, et de préserver le plus longtemps possible l’activité des antibiotiques.
Ces recommandations ont pour objectif le bon usage des antibiotiques, et plus particulièrement de faciliter au sein des établissements de santé la mise en place de stratégies d’antibiothérapie les plus efficaces et permettant de prévenir l’émergence des résistances bactériennes : elles correspondent à l’actualisation des recommandations publiées en 1997 par l’Anaes sur « le bon usage des antibiotiques à l’hôpital ».
Ces recommandations sont fondées sur l’étude de la littérature française et internationale, les dispositions réglementaires actuellement en vigueur et l’avis d’experts. Elles ne comportent pas de « recettes antibiotiques ». Elles contiennent des règles utiles à la prescription, ainsi que les éléments essentiels à une politique antibiotique à l’hôpital. Chaque établissement de soins doit utiliser ces recommandations pour mettre en place une politique antibiotique consensuelle.
Tous les professionnels de santé, y compris les gestionnaires, ont leur part de responsabilité, et donc un rôle dans le bon usage des antibiotiques à l’hôpital.
Les acteurs et instances mobilisées chaque jour à l’Hôpital :
- Le Centre hospitalier de Chartres compte de nombreux acteurs et instances impliqués :
- Les Docteurs en pharmacie et leurs équipes de la Pharmacie à Usage Intérieur ;
- L’équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH), dirigée par un pharmacien biologiste ;
- Le laboratoire de biologie médicale ;
- L’ensemble des équipes médicales et paramédicales.
Le Centre hospitalier compte par ailleurs un Praticien hospitalier infectiologue, qui anime la Commission des Anti Infectieux, mises en place dans l’établissement en conformité aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), entre autres exigences réglementaires prévues à cet effet.
Psychiatrie Infanto-juvenile
Psychiatrie Infanto-juvenile
Un service de psychiatrie infanto-juvénile, pleinement engagé au sein du Groupement Hospitalier de Territoire.
Il comprend
- Un Service de psychiatrie infanto-juvénile (SPIJ) constituée d’une Clinique des Adolescents départementale,
- Un Hôpital de jour Enfant,
- Un Hôpital de jour Adolescent,
- Une Unité de Diagnostic et de Traitement des Troubles Envahissants du Développement (UDITTED),
- Des unités ambulatoires (Centre Médico-Psychologique (CMP),
- Un Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP),
- Une Equipe Mobile pédopsychiatrique,
- Une équipe territoriale d’appui primaire de 0- 12ans (ETAP).
Il collabore au sein du Pôle de Psychiatrie infanto-Juvénile avec le secteur Handicap, constitué de
- La Maison des personnes autistes du département d’Eure et Loir Docteur Jacques Constant (MDPA), comprenant :
- Un Institut Médico-Educatif (IME),
- Un Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) 14-24 ans.
- Un SESSAD Enfants et Pré Adolescents (EPA) 6-14 ans.
- Le Centre d’Accueil Médico –Social Précoce (CAMPS) du Centre hospitalier de Chartres, rattaché au Pôle Femme Enfant, prenant en charge, dans le cadre d’une activité de consultation et d’expertise, des enfants porteur d’un handicap sévère, âgé de 0 à 6 ans.
Les enjeux de la prise en charge en psychiatrie infanto juvénile à Chartres et en Eure et Loir sont les suivants
- Organiser les conditions de repérage précoce des troubles psychiques sur chaque territoire de santé ;
- Développer un accès rapide au diagnostic et à une prise en charge adéquate :
- Faciliter l’accès à une première consultation en réduisant les délais de rendez-vous en CMP ;
- Développer les pratiques avancées (premier entretien avec un infirmier compétent en psychiatrie) ;
- Favoriser la coordination des acteurs (médecins généralistes, psychologues, psychiatres, établissements médico-sociaux, professionnels de l’éducation nationale) en vue d’organiser la continuité du parcours de santé des personnes souffrant de troubles psychiques et d’éviter les ruptures de prise en charge.
- Développer les prises en charge ambulatoires notamment en travaillant sur le développement des possibilités d’aval.
- Favoriser les apprentissages et le parcours des enfants et des jeunes en situation de handicap, notamment en renforçant les partenariats entre les acteurs institutionnels, le secteur médico-social et les structures accueillant les enfants en milieu ordinaire ;
- Renforcer l’efficience du diagnostic et de l’accompagnement précoce de l’autisme ;
- Accompagner les parcours institutionnels, scolaires et universitaires afin d’éviter les ruptures dans le parcours de la prise en charge des enfants, adolescents et jeunes adultes tant sur le plan scolaire, éducatif que thérapeutique.
Parmi les projets en cours de déploiement au cours des années 2020 - 2024 figurent
1 - La mise en place effective d’une équipe territoriale d’accueil primaire pour enfants de 0 à 12 ans (ETAP enfants).
Contexte et objectifs : Le dispositif « ETAP Enfants », porté par les trois secteurs de psychiatrie infanto-juvénile du département vient, avec la maison des adolescents pour les 12-21 ans, compléter l’offre ambulatoire dédiée à la population infanto-juvénile et améliore les réponses en termes de réduction des délais d’attente pour un premier rendez-vous, d’accueil rapide des situations de crises et de renforcement des prises en charge au CMP. L’objectif du « même panier de service », quel que soit le lieu de résidence des familles, implique l’implantation du même dispositif d’accueil pour enfants sur l’ensemble du territoire eurélien (Dreux, Chartres, Nogent-Le-Rotrou et Châteaudun). Le dispositif « ETAP Enfants » deviendra ainsi le guichet unique pour l’accueil de toute nouvelle demande adressée à la pédopsychiatrie concernant un enfant de moins de 12 ans. Cette organisation intégrée avec un maillage territorial permet de réduire de manière significative les délais d’attente pour un premier rendez-vous (Un accueil dans le mois qui suit la demande et dans la semaine pour les situations critiques) et de disposer d’un relevé unique pour cette activité d’accueil primaire sur l’ensemble du territoire.
2 - La mise en place effective d’une extension territoriale de la Maison Départementale pour Adolescents : « création d’une antenne MDA à Chartres »
Contexte et objectifs : La MDA fournit aux adolescents et acteurs concernés par l’adolescence des informations, des conseils et une aide au développement d’un projet de vie. Elle permet d’apporter une réponse de santé aux adolescents qui ne sont pas pris en charge dans les dispositifs traditionnels, de graduer les réponses apportées et de n’orienter, auprès des unités de soins, que les jeunes qui relèvent de soins psychiatriques et qui feront dans ce cas l’objet d’un projet personnalisé de soins formalisé (PPS). De plus, elle coordonne les autres besoins de santé : consultations somatiques en lien avec les Centres Hospitaliers du département, planning familial, dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), d’addictologie, d’éducation nutritionnelle…
Le projet d’extension et de couverture territoriale implique l’implantation d’une antenne de proximité à Chartres et de deux permanences d’accueil avancées au sein des villes de Nogent le Rotrou et de Châteaudun. Elles seront assurées par les équipes des antennes de Dreux et de Chartres.
Cette organisation offre, dans le cadre des « permanences d’accueil », un accueil sans délai d’attente ou sur rendez-vous. Elle contribue au dépistage précoce des jeunes les plus en difficultés et permet d’organiser leur accompagnement médico-psycho-social. La tranche d’âge ciblée est de 12 à 21 ans (accueil à partir de 11 ans pour les jeunes collégiens).
3 - Le projet d'extension Territoriale de l'Equipe Mobile de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent
Contexte et objectifs: Le département de l’Eure et Loir nécessite la mise en place d’une équipe mobile départementale pédopsychiatrique coordonnée, couvrant deux axes (Chartres-Châteaudun et Dreux-Nogent le Rotrou) et travaillant aux fins de complémentarité et de mutualisation des moyens.
Le projet d’équipe mobile prévoit quatre niveaux d’intervention :
- La psychiatrie de liaison pour les enfants de moins de 16 ans (pédiatrie, autres services de soins somatiques, unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD)) ;
- Les institutions sociales et médico-sociales et si besoin le domicile familial de l’adolescent ;
- L’accueil primaire de situations de crise (but : offrir une alternative à l’hospitalisation) ;
- Les consultations post-crise avec ou sans hospitalisation initiale en pédiatrie dans l’attente d’un relai avec les dispositifs de prises en charge existants.
4 – Le projet de regroupement du service de Psychiatrie Infanto Juvénile à l’Hôtel Dieu
Contexte et objectifs: La vétusté des bâtiments situés sur le site Saint Brice et l’impossibilité d’une restructuration et /ou de nouvelles constructions dans ce périmètre géographique (plan local d’urbanisme) imposent l’engagement d’une réflexion en vue d’un regroupement des activités de ce pôle sur le site de l’Hôtel Dieu. Cette contrainte urbanistique offre l’opportunité d’une optimisation des ressources et moyens dédiés à la prise en charge des enfants et adolescents. Il s’agit, dans le cadre du projet d’établissement 2020-2024, de définir, en lien avec l’ensemble des acteurs impliqués et dans le cadre du schéma directeur immobilier, les perspectives d’une nouvelle implantation à terme. Les atouts en seront la mutualisation des moyens, la réduction du temps de transport et le renforcement de la permanence de soins.
5 - Le projet d'Equipe Mobile d'évaluation des Troubles du Spectre de l'Autisme
Contexte et objectifs: L’accueil dans les structures sanitaires et médico-sociales s’est nettement renforcé et amélioré dans le département par la création, au sein de la Maison Départementale des Personnes Autistes (MDPA), d’un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) pour enfants de 6 à 14 ans (EPA) s’ajoutant à celui accueillant des jeunes de 14 à 24 ans (AJA). De plus, des dispositifs ressources autisme ont été mis en place au sein des Instituts Médico-Educatifs (IME).
Toutefois, l’orientation vers les unités d’évaluation demeure encore tardive, faute d’un développement du repérage précoce au sein des lieux d’accueil et de vie des enfants de moins de trois ans (crèches, nourrices, halte-garderie, domicile….).
L’objectif du « même panier de service », quel que soit le lieu de résidence des familles, implique la couverture de l’ensemble du territoire eurélien et ses différents bassins de population (Dreux, Chartres, Nogent Le-Rotrou et Châteaudun). L’équipe mobile sera en conséquence déployée sur l’ensemble du territoire et couvrira les bassins de Chartres, Dreux, Nogent-Le-Rotrou et Châteaudun.
Le repérage et le diagnostic de l’autisme sont de plus en plus précoces en raison de la présence, notamment de marqueurs comportementaux identifiables dès l’âge de 6 mois. A défaut d’un diagnostic fiable avant l’âge de 2 ans, la plasticité́ cérébrale importante chez le jeune enfant permet à l’intervention précoce d’apporter des modifications significatives de la trajectoire développementale de l’enfant et d’améliorer la qualité de vie au sein de la famille.
6 - La Création de 3 lits de centre d’accueil de crise sur l’unité temps de la clinique des adolescents
Contexte : Actuellement, la clinique des adolescents dispose de cinq lits d’hospitalisations à temps plein et comprend trois soignants le matin et l’après-midi et de deux soignants la nuit.
Il s’agit d’un lieu d’hospitalisation et de soins médico-psychologiques spécialisé dans les soins des jeunes présentant des troubles psychiques aigus insérés ou non dans une pathologie psychiatrique avérée et dont l’état nécessite une hospitalisation à temps complet. La séparation du jeune de manière transitoire avec son milieu familial permet à l’adolescent de mieux faire le point sur ses difficultés propres et ses relations familiales, souvent altérées à cette période ce qui conduit le médecin à mieux cerner la situation d’impasse du moment.
Il est constaté un manque de capacité de réponse adaptée en urgence devant des demandes très pressantes qui ne peuvent pas être accueillies en pédiatrie en raison de l’augmentation de la fréquence des troubles des conduites chez les préadolescents (9 à 13 ans).
Il s’agit, en l’occurrence, de promouvoir la création de trois lits de Centre d’Accueil et de Crise (CAC), qui permettra de fluidifier les parcours de crise dans les services de pédiatrie. La prise en charge sera différenciée et adaptée à l’âge de l’enfant.
Objectif :
- Développer l’offre de soins sur le département d’Eure et Loir ;
- Améliorer la fluidité des parcours de crise dans les services de pédiatrie.
Cardiologie interventionnelle
Cardiologie interventionnelle
Développement du centre de rythmologie interventionnelle
Contexte
On entend par cardiologie interventionnelle tous les actes thérapeutiques en cardiologie réalisés par voie endo-vasculaire (en passant par un vaisseau sanguin). La rythmologie interventionnelle englobe les explorations et interventions permettant d'analyser ou de traiter un trouble rythmique et certains cas d'insuffisance cardiaque.
L'ablation de fibrillation atriale consiste à aller détruire ou isoler des zones de tissu à l'origine de l'arythmie. Le traitement par ablation s'adresse aux patients présentant des symptômes invalidants liés à la fibrillation atriale (FA).
Les pacemakers sont implantés dans le thorax pour réguler et maintenir un rythme cardiaque normal lorsque le nœud sinusal du patient n'est pas en mesure de le faire correctement.
Objectifs
- Atteindre une activité seuil d’ablation de fibrillation atriale ;
- développer l’activité de pacemaker.
Vasculaire interventionnel
Vasculaire interventionnel
PREVENTION DES TROUBLES CARDIO – VASCULAIRES : Pour prendre soin de votre cœur : des gestes simples !
(Source : Fédération Française de Cardiologie)
L’activité physique est l’une des préventions les plus efficaces.
Pour les adultes, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande au moins 30 min/jour d’activité physique modérée (marche soutenue 6-7 km/h) au minimum 5 jours par semaine ou au moins 25 minutes par jour d’activité physique intense 3 fois par semaine.
LES ADULTES NE BOUGENT PAS ASSEZ…
L’inactivité physique et la sédentarité – temps passé assis ou allongé en dehors des heures de repas et de sommeil – sont parmi les tout premiers facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires. Selon l’étude Esteban publiée fin 2017 par Santé Publique France, le temps moyen passé par les adultes devant les écrans est passé de 3h10 par jour en 2006 à 5h07 en 2016. Il a progressé de 44 % chez les hommes et 66 % chez les femmes sur la période ! Seulement 53 % des femmes en France satisfont aux recommandations de l’OMS en matière d’activité physique, contre 70 % des hommes. On observe depuis dix ans, une baisse préoccupante (-16 %) de la proportion de femmes physiquement actives…
… ET LES ENFANTS ENCORE MOINS !
Le niveau d’activité physique chez les enfants et les adolescents est alarmant. Depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique. C’est-à-dire qu’ils courent moins vite et moins longtemps. En moyenne, un collégien courait 600 mètres en 3 minutes en 1971. Il lui en faut aujourd’hui 4 pour la même distance. Cette évolution est liée à la progression de la sédentarité chez les jeunes, elle-même en phase avec le développement du surpoids et de l’obésité.
L’OMS recommande aux 5-17 ans de pratiquer 60 minutes d’activité physique par jour afin de renforcer leur capital santé cardio-vasculaire. Ce niveau est loin d’être atteint en France, où les enfants de 3 à 17 ans passent en moyenne 3 heures par jour devant des écrans, moyenne qui monte à 6 h le week-end.
Unité de Recherche clinique
Unité de Recherche clinique
Recherche et innovation : Le service cardiologie de Chartres, un service reconnu à l’échelon national !
Sous la coordination médicale du Dr Rangé et paramédicale de C. Laure, le service de cardiologie de Chartres développe depuis de nombreuses années une activité de recherche et s’est à nouveau illustré dans la coordination du registre France PCI, un observatoire national de l'activité de coronarographies et d'angioplasties coronaires français, dont la méthodologie s'est fortement inspirée du registre suédois SCAAR.
Hépathologie - maladie du foie
Hépathologie - maladie du foie
Cirrhose, hépatite aiguë et chronique, alcoologie, hépatites virales, etc.
Gastroentérologie
Gastroentérologie
Maladie inflammatoire du colon, diarrhée chronique, hémorragie digestive, pathologie ulcéreuse, maladie bilio-pancréatique, cancer digestifs...
Proctologie
Proctologie
Maladie hémorroïdaire et pathologie de l'anus, diagnostic et thérapeutique, etc.
Médecine interne
Médecine interne
Maladies auto immunes, maladie coeliaque, anémie, hémochromatose, etc.
Hôpital de jour
Hôpital de jour
Saignée, ponction d'ascite, transfusion, biothérapie dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, etc.